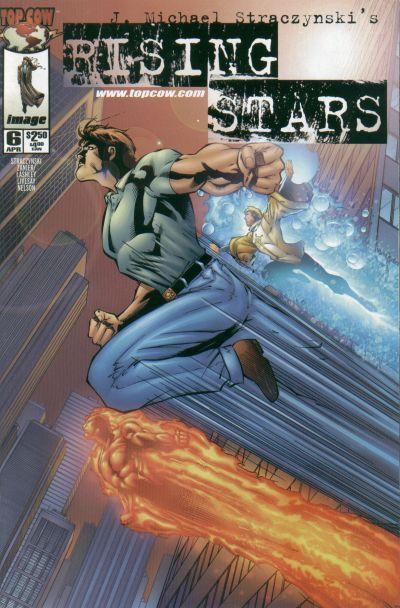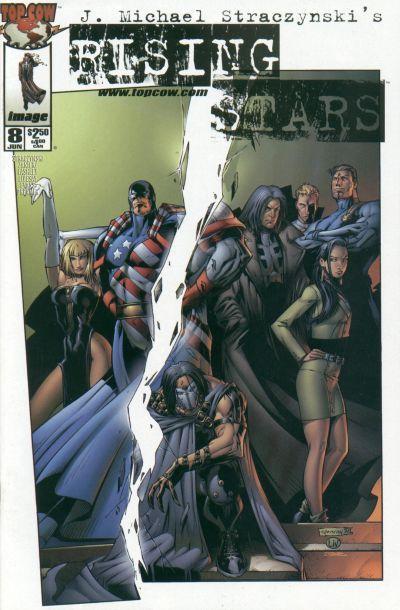Il y a de ces films qui donnent qu’un semi désir de les voir. La Taupe en fait surement parti. C’est donc avec seulement une semi envie que j’ai accepté de l’invitation de nos amis de chez Cloneweb pour aller voir ce film.
Réalisé par Tomas Alfredson. Avec Gary Oldman, Mark Strong, Colin Firth et Benedict Cumberbatch. En salles le 8 février 2012.
1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Les services secrets britanniques sont, comme ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission ratée en Hongrie, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George Smiley.
Pourtant, Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l’injonction du gouvernement, qui craint que le service n’ait été infiltré par un agent double soviétique. Epaulé par le jeune agent Peter Guillam, Smiley tente de débusquer la taupe, mais il est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un redoutable espion russe, Karla. Alors que l’identité de la taupe reste une énigme, Ricki Tarr, un agent de terrain en mission d’infiltration en Turquie, tombe amoureux d’une femme mariée, Irina, qui prétend posséder des informations cruciales. Parallèlement, Smiley apprend que son ancien chef a réduit la liste des suspects à cinq noms : l’ambitieux Percy Alleline, Bill Haydon, le charmeur, Roy Bland, qui jusqu’ici, a toujours fait preuve de loyauté, le très zélé Toby Esterhase… et Smiley lui-même.
Dans un climat de suspicion, de manipulation et de chasse à l’homme, tous se retrouvent à jouer un jeu dangereux qui peut leur coûter la vie et précipiter le monde dans le chaos. Les réponses se cachent au-delà des limites de chacun…
Sorte d’enquête dont la but est en réalité de démasquer l’infiltré russe au sein des services secrets anglais, La Taupe présente un certain potentiel. En effet, de premier abord, il promet suspense, doutes, et complexité. Malheureusement, peut-être trop complexe, le film lasse vite, et le spectateur, perdu dans un nombre de détails souvent faussement nécessaires, s’embourbe complètement, sans forcement avoir envie de finalement s’en sortir.
Jolie pièce de mise en scène, La Taupe propose malgré tout une imagerie très stylisée et une lumière presque impeccable. Le casting fait lui aussi un sans faute, nous proposant notre Sherlock préféré, Benedict Cumberbatch, en enquêteur débutant. Sa prestation ici confirme une fois de plus qu’un belle carrière s’annonce pour lui, et ce, espérons le, au cinéma. Cependant, le reste du casting, c’est à dire une belle brochette d’acteurs connus et reconnus (de Colin Firth à Gary Oldman en passant par Tom Hardy ou encore John Hurt), n’est pas foncièrement mis en avant. Surement parce que le scénario nous lasse tellement qu’il ne nous permet pas, ou du moins ne nous donne nullement l’envie, de chercher à creuser un peu plus qui sont les différents hommes qui prennent place au milieu de l’investigation. Parce que oui, le grand soucis que pose ce film est qu’avec son scénario digne d’un encyclopédie, on se retrouve face a un film sans la moindre action, et donc d’un plat affolant.
Enfin, je ne sais pas si l’équipe de Cloneweb et moi sommes stupides, mais il faut avouer qu’à la sortie, les indices ayant amenés à determiner qui était la fameuse Taupe m’ont paru très flous, et assez décousus. Peut-être mon manque d’attention face à l’ennui m’a t-il encore joué des tours, ou alors après avoir passé trois heures à nous peindre un tableau complexe, les scénaristes se disent que plus personne n’y comprendra assez pour voir que leur conclusion ne sort plus de nulle part.
Pour finir, je pense que vous l’aurez compris, malgré beaucoup de bonnes choses, La Taupe est un film assez difficile a ingérer. A vouloir jouer sur un scénario trop solide, on finit par légèrement s’y casser les dents. Assez dommage, donc.
Karine La Taupe